Première phase : la Mission spiritaine
02 octobre 2022 – 02 octobre 2024
« S’attacher aux anciens usages, rester dans les habitudes et l’esprit qui prévalaient alors, c’est rendre nos efforts inutiles… Embrassons donc avec franchise et simplicité l’ordre nouveau et apportons-y l’esprit du saint Évangile, et nous sanctifierons le monde, et le monde s’attachera à nous » (François-Marie Paul Libermann, N.D., X, 151).
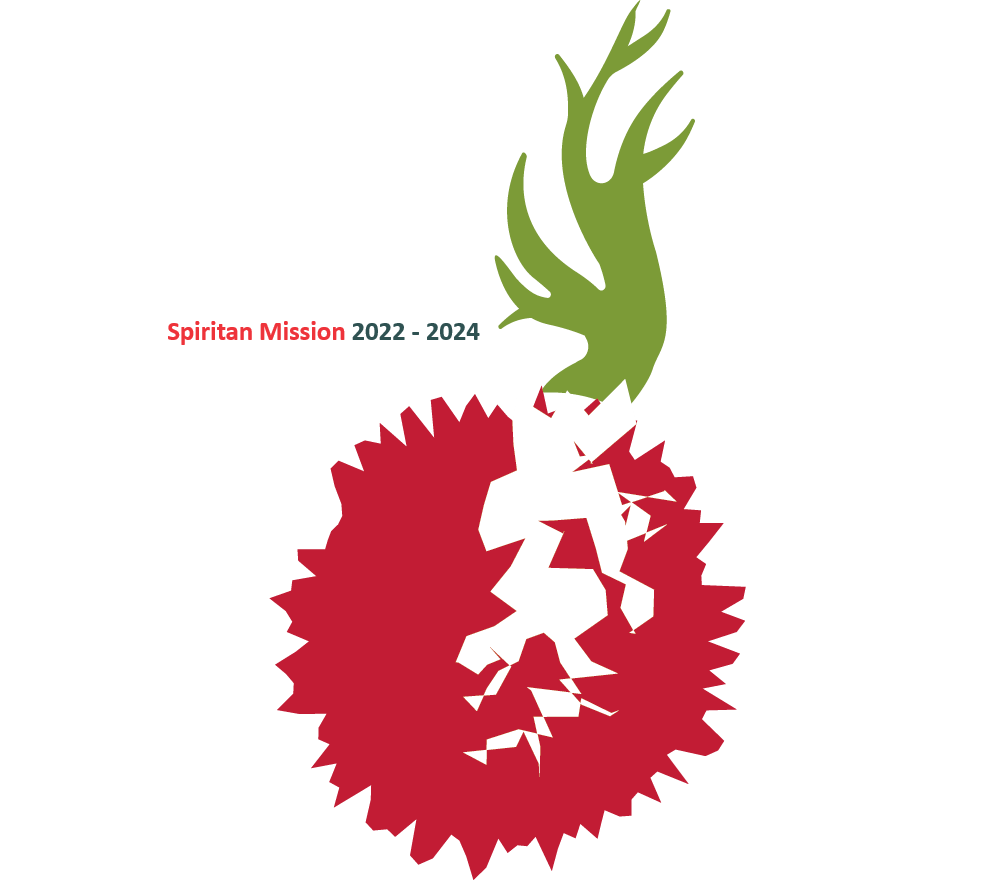
Frères et sœurs de la Famille Spiritaine,
Au début du mois d’août, le Conseil général a envoyé la version électronique des documents de notre Chapitre général de Bagamoyo II, et j’espère que chacun d’entre vous l’aura reçue, et aura peut-être eu aussi l’occasion de la lire. La version papier est en cours d’acheminement. Avec la publication de ce document, la phase de mise en œuvre de l’invitation de Bagamoyo II à faire « quelque chose de neuf » en relation avec notre identité spiritaine a commencé. Bagamoyo II a reconnu que les nouvelles formes de pauvreté qui apparaissent dans notre monde d’aujourd’hui exigent des manières nouvelles et créatives de vivre l’Évangile. Il nous invite à élargir notre vision et à prendre les risques nécessaires, à envisager de nouvelles initiatives dans notre manière de répondre aux besoins de la mission spiritaine aujourd’hui.
Le Chapitre a insisté sur un changement d’approche et de style de mission, sur le courage d’abandonner les engagements qui ne sont pas conformes à notre charisme en faveur de ceux qui le sont davantage ; en d’autres termes, « à ne pas s’accrocher à des modèles missionnaires qui ne correspondent plus aux besoins du monde contemporain. » (Lettre du Supérieur Général, Pentecôte 2022). Cet appel s’adresse à chacun de nous individuellement, à chaque communauté et à chaque circonscription. Comme annoncé dans la Lettre de Pentecôte, le Conseil général propose, à partir de ce 2 octobre 2022, un processus d’animation à l’échelle de la Congrégation, jusqu’au prochain Chapitre général, selon trois axes : Mission, Spiritualité et Vie communautaire interculturelle.
A partir d’aujourd’hui, 2 octobre 2022, et jusqu’au 02 octobre 2024, nous réfléchirons sur notre Mission spiritaine. Bagamoyo II nous appelle à faire progresser la mission spiritaine en répondant concrètement aux signes des temps à la lumière de notre charisme. Le but est que chaque circonscription de la Congrégation précise ses orientations missionnaires en accord avec les décisions de Bagamoyo II. Comment pensons-nous pouvoir répondre/vivre la mission spiritaine aujourd’hui, en fidélité à notre charisme ?
Au cours de la première année (2022-2023) de cette phase initiale, le Conseil général propose que nous nous posions la question suivante : Que faisons-nous/qu’avons-nous fait de nouveau ? Il s’agit d’évaluer nos engagements missionnaires, et sur la base des exigences de la mission spiritaine aujourd’hui, de repérer les lieux et les missions que nous pourrions quitter parce qu’ils ne répondent plus à notre charisme.
La deuxième année (2023-2024), nous proposerons de nous projeter dans l’avenir pour envisager les nouvelles missions vers lesquelles nous voudrions nous engager : Si la Congrégation devait commencer aujourd’hui dans votre lieu de vie, dans quelle mission choisirait-elle de s’engager ?
Nous devons être conscients du fait qu’en tant que Congrégation, nous sommes passés de l’ère de l’implantation/fondation d’Églises locales à la phase de consolidation et de collaboration. Par conséquent, la question qui devrait être dans notre esprit devrait être : Qu’apportons-nous, en tant que Spiritains, à l’Église locale lorsque nous entreprenons une mission ? Et comment répondons-nous de manière adéquate aux situations missionnaires urgentes, telles que les nouveaux pauvres dans nos espaces urbains, les migrants, les réfugiés, les prisonniers, les peuples indigènes, les situations d’injustice, les menaces sur la vie et sur l’environnement ? Quelle est l’approche particulière et les engagements que nous apportons à la mission spiritaine que nous sommes appelés à la vivre aujourd’hui ?
Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous ont déjà un emploi du temps très chargé dans leur ministère. Aussi, le plan d’animation proposé n’a pas pour but d’ajouter un autre fardeau à votre calendrier. Il vise plutôt à entraîner chacun d’entre nous, personnellement et collectivement, dans un processus de conversion pour accueillir la Nouveauté dans un esprit de participation et d’écoute, afin de parvenir à une vision commune renouvelée, en particulier en ce qui concerne la Mission, la Spiritualité et la Vie communautaire interculturelle. Nous sommes tous appelés à participer activement à ce processus. Le succès de cette phase dépend du fruit de la conversion personnelle et des changements nécessaires dans le style de vie de nos communautés.
Au cours des prochains mois, vous recevrez des ressources pour vous accompagner dans ce processus – témoignages personnels de confrères, d’associés laïcs et de circonscriptions, suggestions pour les circonscriptions, la réflexion et le partage communautaire, textes pour d’éventuelles célébrations liturgiques. Vous pourriez avoir, vous aussi, des idées et des suggestions que vous souhaiteriez partager avec nous.
Le plan que propose le Conseil général est une invitation à mettre en œuvre l’appel de Bagamoyo II à faire « une chose nouvelle ». Notre avenir même en tant que Congrégation dépend de ce pèlerinage. Que l’Esprit Saint, par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, nous guide sur ce chemin.
Fraternellement dans l’Esprit,
Alain Mayama, C.S.Sp.
Supérieur Général
Cette publication est également disponible en: English Português






